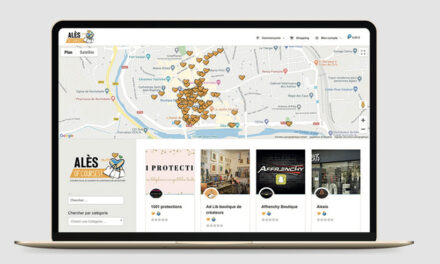La crise des gilets jaunes et l’impossibilité de négocier une sortie du conflit révèle au grand jour l’émergence d’une nouvelle donne dans le paysage politique, celle du poids incontournable désormais de la parole individuelle, apparue grâce aux réseaux sociaux.
Influence et opinion : l’âge de la concentration des médias
Souvenons-nous sans nostalgie que les institutions de notre pays, et au-delà celles des écosystèmes politiques dans lesquels il est intégré (à commencer par l’Europe), ont toutes été définies à un moment où internet et les réseaux sociaux n’existaient pas.
Cela compte dans la balance des pouvoirs, qu’ils soient constitutionnels ou implicites : jusqu’à la fin de la première décennie des années 2000, lorsque le pouvoir en place désirait convaincre, persuader ou (im)poser une analyse, sa principale préoccupation était celle de l’angle à choisir ou de l’image à gérer – moins celle de sa validation par le peuple.
À cette époque les seules inconnues de l’équation restaient les réactions d’une poignée de vis-à-vis : quelques opposants politiques, une douzaine de journalistes ou éditorialistes influents, deux ou trois opposants vaguement écoutés, le représentant en vogue d’un syndicat surpuissant, etc. Le billard médiatique se jouait à plusieurs, mais les participants étaient clairement identifiés.
Les électeurs, cible ultime de cette communication nécessaire, n’étaient alors une masse muette hors des bistrots dont l’électroencéphalogramme ne se réveillait officiellement qu’à l’occasion des élections.
Or ces dernières restaient globalement prévisibles des mois à l’avance grâce aux sondages, boule de cristal politique, qui permettaient d’anticiper les lents mouvements de l’opinion que l’on programmait à cette fin des mois à l’avance. Jacques Pilhan, conseiller tour à tour de François Mitterrand et Jacques Chirac, en savait quelque chose.
Les médias sociaux : la naissance d’une influence sans vassalité
Au début des années 2000 apparurent les blogs. Ces petits médias individuels, accessibles en ligne depuis n’importe quel ordinateur connecté, étaient déjà en eux-mêmes une révolution : leurs auteurs pouvaient réagir à l’actualité par écrit, images à l’appui, et diffuser leur propre point de vue, sans en référer à personne.
On découvrait alors que les journalistes n’étaient pas les seuls à savoir écrire. De petites communautés se créaient. Le format interactif de chaque article permettait d’en faire le point de départ d’une discussion animée où anonymes et blogueurs reconnus échangeaient et confrontaient leurs idées. Enfin, le mail permettait d’envoyer tel ou tel article particulièrement apprécié à son carnet d’adresse pour en propager la lumière de l’instant.
Sur le phénomène des blogs se greffait ensuite celui des réseaux sociaux qui permettait au canal de l’information de trouver une nouvelle voie autonome vis-à-vis de celle, séculaire, des médias traditionnels.
En effet, jusqu’aux années 2010, pour qu’une information soit relayée et qu’elle ait un poids dans l’opinion, il fallait qu’elle parvienne jusqu’aux oreilles d’un journaliste, que celui-ci daigne s’en emparer, que sa démarche soit adoubée par son rédacteur en chef, que le journaliste trouve ensuite assez de matière pour en faire « un sujet » et qu’enfin, pour être publiée, elle passe la sélection des sujets « porteurs » du moment – autrement dit, qu’on la préfère à d’autres.
Cette chaîne de l’information, si elle existe toujours, est aujourd’hui une option parmi d’autres. La démocratisation des smartphones permet à tout un chacun de relayer en temps réel tout événement dont il est témoin. Celle des réseaux sociaux permet à tout internaute d’avoir accès à cette information et de la relayer à sa propre communauté d’abonnés si elle lui semble digne d’intérêt.
Les effets collatéraux de cette nouvelle circulation de l’information sont importants : l’information n’est plus un bloc structuré dont on s’empare chaque soir à 20 heures, elle devient un flux permanent non hiérarchisé et non filtré. Chaque citoyen désireux de convaincre a désormais les moyens d’incarner un message et de constater, par les statistiques des vues de sa vidéo, si son message est reçu ou non.
Qu’on l’approuve ou non, le rapport de force est de fait modifié entre un pouvoir exécutif qui avait jusqu’alors sept ans puis cinq ans pour agir, et un peuple qui le sanctionnait ou le renforçait à chaque élection. Qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi, le peuple a désormais les moyens de remettre en cause les décisions du pouvoir, non parce qu’il peut bloquer les ronds-points (c’était déjà possible bien avant), mais parce qu’il peut désormais mesurer en temps réel l’impact d’une telle démarche aux plans régional et national, voire international.
La question d’un nouveau contrat social
Nos institutions ont été conçues pour une organisation descendante de la société : après les élections, les pouvoirs exécutifs et législatifs décidaient, les médias transmettaient, parfois expliquaient, et si le peuple grondait, cela se passait chacun chez soi, fenêtres fermées, voire au bistrot. Les plus virulents donnaient de la voix dans les syndicats ou les partis politiques.
Aujourd’hui chaque individu mécontent peut gagner à son opinion des milliers, voire des millions d’internautes. « Les électeurs » ne peuvent plus être considérés comme une masse unique et informe dont on autopsie le corps malléable en séparant la « gauche » de la « droite » grâce à des statistiques artificielles.
La crise que traverse la France à l’heure actuelle en est la preuve : face aux gilets jaunes, le gouvernement tente en vain de trouver des interlocuteurs et des revendications consensuelles pour apporter une réponse globale. Chacun ne parle que pour soi, et ne se reconnaît dans l’autre gilet jaune qu’en tant qu’individu revendiquant la portée de sa colère.
Sur le fond, cette crise des gilets jaunes trouve donc certainement son origine dans des revendications économiques (pouvoir d’achat, taxes, impôts, etc.) tout autant que dans la sensibilité révolutionnaire d’une partie du peuple français.
Mais sur la forme, elle est aussi le symptôme d’une crise plus profonde, celle d’institutions qui bien qu’ayant fait leurs preuves révèlent une faille béante entre la façon dont les décisions sont prises et appliquées dans notre pays et la réalité technologique de leur perception, via les réseaux sociaux.
Nos femmes et hommes d’état ne sont plus dans une tour d’ivoire où seuls les éditos du jour pouvaient épisodiquement les égratigner. Ils sont tous les jours jetés en pâture aux citoyens, chacun d’entre eux ayant désormais les moyens de faire mouche.
On ne réduira pas cette fracture sociologique en revenant à l’ancienne manière de gouverner, sauf à passer par un pouvoir autoritaire. La seule solution serait donc de s’adapter à cette prise de parole élargie en allant vers plus de démocratie – directe.
En Suisse par exemple, chaque citoyen est appelé à valider par votation toutes les décisions qui concernent son quotidien. Le vote n’est ainsi plus un blanc-seing que l’on signe pour un quinquennat mais une expression individuelle concrète sur un sujet du quotidien.
Il va de soi que le modèle suisse n’est pas transposable à l’identique dans un pays comme la France, mais c’est néanmoins le sens de l’Histoire : grâce aux réseaux sociaux ou à cause d’eux, le peuple n’est plus un tigre endormi, c’est une ruche perpétuellement en activité. Nos institutions doivent adapter leur façon de communiquer et de gouverner à cette réalité.
Cet article a également été publié dans le Cercle Les Echos.